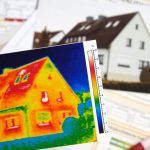Les cicatrices aux bras des personnes ayant reçu le vaccin contre la variole ont majoritairement été observées chez des individus âgés de plus de quarante ans. En effet, la campagne de vaccination contre cette maladie a cessé il y a plusieurs dizaines d’années, et la vaccination de routine contre la tuberculose a également été abandonnée en France depuis longtemps. Par conséquent, la majorité des traces laissées par ces vaccins datent d’époques révolues, lorsque ces campagnes de prévention étaient encore en vigueur.
La variole : un vaccin qui a permis d’éradiquer une maladie mondiale
Jusqu’à la fin des années 1970, la vaccination contre la variole était systématiquement administrée à tous les enfants. La gravité de cette infection virale n’a d’ailleurs pas permis de l’ignorer longtemps : grâce à une importante initiative mondiale menée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), cette maladie a été déclarée éradiquée en 1980. Cette réussite sanitaire a été rendue possible par une campagne de vaccination de masse, unique dans l’histoire de la santé publique, qui a permis d’éliminer cette infection du globe. Aujourd’hui, pour beaucoup de personnes plus âgées, la marque laissée par cette immunisation est visible sous la forme d’une cicatrice sur la partie supérieure du bras gauche.
Ce souvenir visible est une marque arrondie, relativement large, pouvant mesurer environ deux centimètres, qui se distingue par sa profondeur et ses contours parfois irréguliers. Elle constitue le résultat de l’injection du virus vivant de la vaccine, une substance utilisée dans ce vaccin spécifique, réalisée à l’aide d’un instrument appelé aiguille bifurquée, c’est-à-dire équipée de deux pointes. Cette technique particulière a été employée pour administrer le vaccin en perforant la peau à plusieurs reprises.
Selon les explications de l’OMS, lors de cette administration, la méthode à perforations multiples implique l’utilisation d’une aiguille bifurquée pour déposer une petite quantité de vaccin sous la peau. Au moment de l’injection, une petite goutte de sang peut apparaître à l’endroit du geste. Avant que la cicatrice ne se forme, la zone concernée par la vaccination se voit souvent apparaître une papule, une petite bosse sur la peau, qui précède la formation de la cicatrice définitive.
Le BCG : un vaccin ciblé pour certains groupes spécifiques
Le vaccin appelé BCG, pour Bacillus Calmette-Guérin, est utilisé dans la prévention de la tuberculose. Il s’agit d’une maladie infectieuse principalement pulmonaire, très contagieuse, causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Jusqu’à l’année 2007, la vaccination contre la tuberculose était une pratique universelle en France, administrée à tous les enfants peu importe leur contexte.
Depuis cette date, la vaccination BCG n’est plus systématique pour tous, mais elle reste recommandée uniquement pour des groupes spécifiques. Elle concerne notamment les jeunes enfants de moins de 5 ans qui présentent un facteur de risque accru de développer une tuberculose, généralement parce qu’ils sont nés ou ont séjourné dans une région où la tuberculose demeure répandue et difficile à contrôler. La méthode d’administration du BCG est une injection effectuée directement dans le tissu situé juste sous la peau, une technique spécialisée qui peut provoquer une petite ulcération. En cicatrisant, cette ulcération laisse une trace plus discrète que celle laissée par la vaccination contre la variole, mais elle est souvent constatée sur le bras gauche, souvent au niveau de l’épaule.
Ainsi, si la marque du vaccin contre la variole demeure une cicatrice bien visible, celle du BCG tend à être plus discrète, mais toujours présente, surtout chez ceux qui ont été vaccinés durant leur enfance dans le cadre d’un programme de prévention ciblée.